Folie
XVIII Dimanche T.O. –
Pourquoi devrait-on diviser son héritage si ce n’est par peur de le partager ? Loin des exagérations héroïques, le Seigneur Jésus ne s’oppose pas à la richesse en tant que signe d’une manière d’habiter avec responsabilité et passion la terre qui nous a été confiée pour être protégée, cultivée et développée, mais contre la folie de cette privatisation morbide dont le personnage tolkien de Gollum est l’icône. La richesse en soi n’est pas un crime, mais l’inconscience, que l’on soit riches ou pauvres est un crime, – mais, plus subtilement encore – l’inconscience de ceux qui, en réalité ou simplement par manque de jugement, ne sont ni trop riches, ni trop pauvres. Dans sa parabole, le Seigneur Jésus ne dit pas que cet homme qui thésaurisait ses biens est un homme mauvais, il le définit simplement comme « stupide » ( Lc 12, 20 ). Thésauriser n’est pas un mal, mais l’inconscience du pourquoi peut devenir un mal, ou plus précisément du « pour qui » continue-t-on à mettre la vie à part, avec le risque de ne pas réussir à la vivre pleinement.
Le soliloque du personnage de la parabole résonne ainsi : « je démolirai mes entrepôts et j’en construirai d’autres plus grands et j’y engrangerai tout le grain et tous mes biens. ( Lc 12, 18 ). Le soliloque du Qohélet semble faire voler en éclats la proposition du riche propriétaire par un tonitruant : « cela aussi est vanité ! » ( Qo2, 23 ). De son côté, l’apôtre nous met en garde contre le risque de nous aplatir sur la terre, alors que nous sommes appelés à partager le don et la responsabilité de l’habiter de façon consciente et solidaire : « chercher les choses d’en-haut » ( Col 3, 2 ). Le Seigneur Jésus ne ridiculise pas la bonne richesse de celui qui peut faire toute chose avec justice, mais il cherche de mettre en évidence comment chaque justice est partiale. Au lieu d’être arbitre comme Moïse qui, en Egypte, tua l’égyptien pour défendre l’hébreu, le Seigneur nous offre un critère qui nous permet d’aller au-delà de la justice qui pourtant reste nécessaire : « Il en est ainsi de celui qui accumule des trésors pour soi et ne s’enrichit pas auprès de Dieu » ( Lc 12, 21 ). Il semblerait vraiment que la chose la plus importante soit celle de dilater sa propre référence relationnelle en devenant capables d’un regard à la hauteur de celui du Très-Haut qui, par différents aspects, s’exprime selon l’adage du Qohélet : « Vanité des vanités, tout est vanité » ( Qo 1, 2 ).
Une manière de se soustraire à la logique suffocante de l’auto – référence est de se fier aux pauvres qui sont les gardiens et les portiers du Règne qui vient et cela parce qu’ils se rappellent la précarité liée à la vie. L’évidence acquise avec laquelle le Qohélet affirme que chacun de nous devra donc « laisser sa part à un autre » ( Qo 2, 21 ), rend encore plus admirable la façon dont le Seigneur se soustrait à la demande d’arbitrer le partage de l’héritage de ces deux frères. Ainsi, il ne veut pas abdiquer au devoir de rétablissement de la justice, mais le Seigneur se préoccupe d’ouvrir nos yeux sur l’essentiel de la vie. Et ceci parce que nous risquons trop facilement de perdre de vue l’horizon vers lequel la vie est appelée à se jouer : pendant que nous nous construisons des entrepôts toujours « plus grands », la vie, qui trouve son véritable sens dans la relation et le partage, risque de nous rétrécir à vue d’oeil !


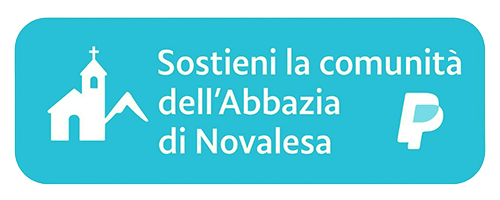



Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!