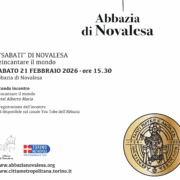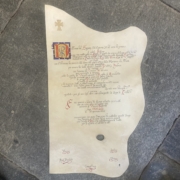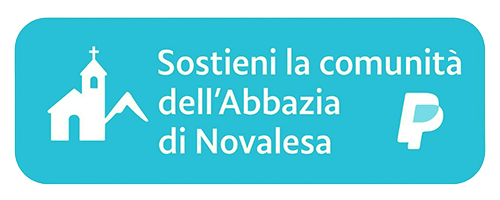Come lui
/0 Commenti/in Oggi è la parola/da EldradusIV Settimana T.O. –
Le due letture ci mettono di fronte a un momento di consegne: <i giorni di Davide si erano avvicinati alla morte> (1Re 2, 1) e il re Davide sente il bisogno di fare delle <raccomandazioni al figlio Salomone>. Il Signore Gesù comincia ad inviare i Dodici e a mandarli <a due a due> (Mc 6, 7) proprio mentre la sua parola comincia a fare il suo duplice effetto sull’ambiente circostante. Da una parte infatti molti ne sono toccati e profondamente cambiati ma – subito dopo – veniamo a sapere che il cerchio della persecuzione e della eliminazione comincia a stringersi e, per questo, si fa memoria della morte del Battista. Davide sul letto di morte e il Signore Gesù in un momento di solitudine e di ritiro trasmettono in eredità la grazia e il segreto della loro relazione con Dio facendone un testamento ed una consegna. Le parole del re Davide sono assai semplici ma di grande forza: <Io me ne vado per la strada di ogni uomo sulla terra. Tu sii forte e mostrati uomo> (1Re 2, 2). Sul letto di morte e nella coscienza delle luci e delle ombre della sua lunga e avventurosa vita, ancora una volta possiamo ammirare e ricevere in consegna insieme a Salomone il duplice segreto davidico. Da una parte l’umiltà, che fa sentire Davide sempre un uomo come <ogni uomo sulla terra> e, dall’altra, il dovere di essere fino in fondo fedele al proprio essere <forte>: sviluppare e far fruttare fino in fondo le proprie potenzialità di <uomo> secondo il cuore di Dio senza nessuna pigrizia e senza cedere a nessuna paura.
Parimenti il Signore Gesù, dando le consegne ai suoi discepoli e affidando a loro il compito di amplificare la sua parola e annunciare il suo vangelo, si mostra assai generoso e fiducioso: <dava loro il potere sugli spiriti impuri> (Mc 6, 7). Il Maestro non invia i suoi discepoli con “poteri limitati” ma con tutta la forza travolgente e trasformante del regno di Dio. E proprio perché si manifesti la potenza di Dio attraverso la loro parole e i loro gesti, il Signore chiede ai suoi discepoli di muoversi con grande agilità, libertà e rigore. Per questo <ordinò loro di non prendere per il viaggio nient’altro che un bastone: né pane, né sacca, né denaro nella borsa; ma di calzare solo i sandali, e di non portare due tuniche> (6, 7-8).
Nessun atteggiamento protettivo da parte del Signore nei confronti dei suoi discepoli né da parte di Davide verso Salomone, ma una preoccupazione iniziatica che, avendo fiducia nelle risorse di ciascuno, mette ognuno nella condizione di dare il meglio di sé pur nella condizione più svantaggiata e precaria. Davide chiede a Salomone di essere fedele alla <legge del Signore tuo Dio, procedendo nelle sue vie> (1Re 2, 3) e il Signore Gesù chiede ai suoi discepoli di non temere nulla durante il loro cammino neppure il rifiuto: <andatevene e scuotete la polvere di sotto ai vostri piedi> (6, 11). Questa forza e questa audacia, lasciata come eredità e consegnata come atteggiamento, permettono a Salomone di sedere <sul trono di Davide suo padre e il suo regno di consolidò molto> (1Re 2, 12). Questa forza dà ai discepoli, ormai divenuti apostoli, la capacità di predicare che <la gente si convertisse, scacciavano molti demoni, ungevano con olio molti infermi e lo guarivano> (Mc 6, 12-13). E noi di cosa mai abbiamo paura? Per ciascuno risuona il monito davidico ed evangelico: <Tu sii forte e mostrati uomo> (1Re 2, 2).
Contare
/0 Commenti/in Oggi è la parola/da EldradusIV Settimana T.O. –
Il re Davide dimentica il segreto della sua elezione che è la sua piccolezza e non la sua grandezza. Per questo, quasi inavvertitamente, cade nella trappola, di chi vuole contare le proprie forze dimenticando come e quanto l’energia che dà vita e permette di affrontare le situazioni più diverse dell’esistenza viene da Dio e non dalla quantità delle proprie risorse: <fate il censimento del popolo, perché io conosca il numero della popolazione> (2Sam 24, 2). Così anche i Nazaretani, invece di accogliere semplicemente e veramente Gesù in mezzo a loro come testimone e portatore di una parola da parte di Dio, cominciano a fare il “computo” di ciò che questa presenza può apportare e comportare. In realtà non è il numero delle nostre forze a darci la forza, ma la qualità della nostra relazione, per questo al Signore Gesù non rimane molto da dire o da fare. L’evangelista annota tristemente: <E si meravigliava della loro incredulità> (Mc 6, 6).
La domanda che i compatrioti di Gesù si pongono si può riassumere così: come può Dio parlare come noi e attraverso uno di noi? Forse, davanti alla profezia che lo Spirito non smette di suscitare al cuore del suo popolo, anche noi possiamo porci e porre la medesima domanda: Gesù è troppo vicino e poco speciale per essere affidabile e, soprattutto, per rappresentare una risposta alle nostre attese e alle nostre illusioni? Il Signore ci scomoda e noi non vogliamo essere scomodati. Il Signore ci sorprende, ma pure è sorpreso dalla nostra chiusura alla sua presenza e al suo messaggio di liberazione condivisa, donata in stile fraterno e non altisonante. Nel modo di porsi del Signore Gesù semplice e familiare è racchiusa una rivelazione che tocca profondamente la nostra vita tanto da poterla effettivamente ed efficacemente trasformare. Come dice un testimone dei nostri giorni: <Per il cristiano se Dio è l’Altissimo non lo è perché è Onnipotente, ma perché è il Tutt’Amante. La sua trascendenza è costituita dal suo amore assoluto>1.
Se in Davide è l’esperienza del potere a generare una sorta di miopia unita ad una perdita di memoria dell’opera di Dio nella sua vita, negli abitanti di Nazaret è la potenza della parola e dei segni compiuti da Gesù e renderli ciechi e sordi per evitare di lasciarsi interpellare e convertire da questa presenza così conosciuta e così nuova ed inedita. Ancora oggi nella <sinagoga> dei luoghi concreti della nostra vita e della nostra ricerca di senso, il Signore Gesù corregge il nostro modo di pensare Dio e di pensare noi stessi. È difficile, infatti, per gli abitanti di Nazaret, come per ciascuno di noi, accettare lo <scandalo> (Mc 6, 3) che proviene dalla serietà del mistero dell’incarnazione che ha come conseguenza una radicale assunzione della nostra umana condizione senza sconti e senza scorciatoie e che non può essere oggetto di nessun <censimento> perché l’amore non si può in nessun modo contare.
1. Card. VAN THUAN, Sur le chemin de l’espérance, Le Sarment, Paris 1991, pp. 54-55w.
Il Chronicon: un monastero affacciato sul mondo
/0 Commenti/in news-generali/da Fabio ZanchettaSospeso
/0 Commenti/in Oggi è la parola/da EldradusIV Settimana T.O. –
Lo spettacolo di Assalonne <sospeso fra cielo e terra; mentre il mulo che era sotto di lui passò oltre> (2Sam 18, 9) ci riempie di commozione soprattutto se assistiamo a tutto ciò non con gli occhi dei prodi di Davide, i quali approfittano di questa occasione per farsi militarmente onore uccidendo il figlio usurpatore del re, ma con il cuore del re il quale invece alla notizia <fu scosso da un tremito, salì sul piano di sopra della porta e pianse> (19, 1). Non sono forse gli stessi sentimenti di Davide – e ancora più profondi – quelli che animano il Signore Gesù che, nonostante tutte le evidenze della morte, si reca a casa di Giairo per compiere un gesto più intimo che miracoloso: <presa la mano della bambina e le disse: Talità kum> (Mc 5, 41).
Assalonne rimane impigliato nella propria insensibilità all’amore di suo padre Davide e rimane talmente sospeso al suo narcisismo di prode coraggioso e bello – ammirato dai soldati e lusingato dalle donne – da essere abbandonato dalla <mula> su cui cavalcava e su cui forse ingenuamente confidava: si crea nel cuore e nella vita del giovane Assalonne una separazione incomunicabile tra l’elemento più istintuale e quello più razionale. Ben si addicono al giovane le parole del salmo:<Non siate come il cavallo e come il mulo privi di intelligenza; si piega la loro fierezza con morso e briglie> (Sal 31, 9). Assalonne pensa di poter fare a meno della sua relazione filiale mettendosi contro suo padre fino ad umiliarlo davanti al popolo, ma così facendo si mette contro se stesso rendendosi così vulnerabile da coprirsi quasi di ridicolo: <Allora Ioab prese in mano tre dardi e li ficcò nel cuore di Assalonne, che era ancora vivo nel folto della quercia> (2Sam 18, 14).
Ben diverso è l’atteggiamento della donna emorroissa che vuole toccare <anche solo a toccare le sue vesti> (Mt 5, 28) e di Giairo che condivide gli stessi intensi sentimenti paterni di Davide ma la cui figlia è di certo più docile di Assalonne in quanto riesce ad ascoltare persino quando è avvolta oramai nel sudario dell’insensibilità della morte. Ma nulla è perduto con la docilità, tutto è perduto con la supponenza. Come spiega Ambrogio di Milano: <È la fede che tocca Cristo; è la fede che lo vede. Se dunque vogliamo anche noi essere guariti, tocchiamo mediante la fede, la frangia di Cristo. Egli non ignora quanti toccano la sua frangia. Beato dunque chi tocca almeno l’estremità del Verbo; chi può infatti afferrarlo interamente?>1. Ciascuno di noi è sempre sospeso tra narcisismo ingannevole e umile docilità al tocco di una relazione che può farci vivere in una pienezza che da soli non possiamo in nessun modo darci. Non sottovalutiamo il nostro bisogno di essere soccorsi e aiutati, non sopravvalutiamo il nostro desiderio di autonomia: la vita intera ci è data come occasione per trovare un equilibrio che nell’umiliazione è più facile trovare, che non ne tempo dell’esaltazione.
1. AMBROGIO DI MILANO, Omelie sul vangelo di Luca, 6, 57-59.
Visite alle Cappelle
/0 Commenti/in news-generali/da EldradusLe visite guidate alle cappelle riprenderanno sabato 21 Marzo 2026 con l’orario consueto.
Accogliere… il bambino
/0 Commenti/in Oggi è la parola/da EldradusPresentazione del Signore –
Quaranta giorni dopo il Natale è come se dovessimo rimetterci in cammino, come già fecero i pastori e i magi, nella notte illuminata dalle voci esultanti degli angeli e dal chiarore commovente di una stella. Questa volta però né angeli né stella indicano il cammino, bensì una voce e una luce che sono assolutamente interiori. È come se in questo tempo – quaranta giorni sono un periodo denso e completo – qualcosa in noi dovesse essere cresciuto nella forma dell’intuizione interiore. Questa rara intuizione indica una maturità che si fa pienezza e al contempo perfetto abbandono. Di questo sentire, riconoscere, accogliere e, in certo qual modo, congedarsi nel e dal mistero dell’incarnazione, sono icone bellissime e affascinanti i due vegliardi: Simeone ed Anna. Luca parlandoci di loro non ha bisogno di scomodare gli angeli come ha già fatto per l’annuncio a Zaccaria, a Maria, ai pastori e come Matteo ha evidenziato evocando il combattimento di Giuseppe. Non c’è bisogno di scomodare neppure stelle luminescenti come nel caso dei Magi. Tutto si svolge ad un livello di interiorità: <Mosso dallo Spirito, si recò al tempio… anch’egli lo accolse tra le braccia> (Lc 2, 27-28).
La sfida della festa di oggi ci riguarda profondamente come credenti perché rimanda alla sfida di tutta la nostra vita di fede: accogliere lo Spirito in un bambino… anzi, in questo bambino concreto che viene presentato al tempio come un bambino qualunque da genitori che non hanno nulla di speciale e che sono assolutamente confusi tra la folla di quanti cercano di compiere ciò che <è scritto nella legge del Signore> (2, 23). Di fatto noi siamo, nella nostra esperienza di vita e di fede, molto più prossimi a Simeone ed Anna che non ai pastori e ai magi. La festa di oggi, chiamata in Oriente festa dell’Incontro, ci rimanda alla necessità di fare un passo verso il Signore, un passo che ci nasca dal cuore e che sia l’espressione esterna di una intuizione interiore che viene dallo Spirito. In realtà, quest’intuizione fa tutt’uno con la totalità del nostro essere e ci mette in cammino. Luca ricorda solennemente: <C’era anche una profetessa…> (2, 36). Speriamo di esserci anche noi per non mancare all’appuntamento di ogni visita che Dio fa alla nostra umanità.
Il vecchio Simeone non è da solo: con cui e in lui opera lo Spirito, così intimo da essere una realtà così familiare per quest’uomo dell’attesa e del desiderio. È lo Spirito che lo spinge verso il Tempio e gli permette di riconoscere e di proclamare la <salvezza> (2, 30) che è per tutti (2, 31). Anche a noi è chiesto di cogliere e rafforzare il nesso tra la nostra vita e il progetto di Dio, tra quello che vediamo e ciò che il nostro cuore è chiamato a sentire e a discernere. La domanda si pone: <che cosa mai hanno colto Simeone e Anna in questo bambino che non doveva essere per nulla diverso da tutti gli altri che venivano quotidianamente portati al Tempio?>. La Lettera agli Ebrei ci fa intuire qualcosa quando dice che <proprio per essere stato messo alla prova e aver sofferto personalmente, egli è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova> (Eb 2, 18). Il <fuoco> (Mal 3, 2) annunciato dal profeta Malachia, con toni abbastanza minacciosi, si fa <luce> (Lc 2, 32) nel tremulo mistero dell’incarnazione. Una luce che, come ci aiuta a comprendere il gesto liturgico che accompagna la celebrazione della Candelora, possiamo tenere tra le mani senza timore di esserne bruciati, ma nella tenera sensazione di esserne rischiarati e riscaldati. Simeone e Anna sono capaci di riconoscere e di cantare un modo nuovo con cui Dio abita il tempio e inabita l’umanità. Esso è un modo discreto, dolce, amorevole: in una parola <bambino> (2, 22.27.38). Simeone e Anna sono dei vegliardi ritornati bambini… rinati in verità… e tra piccoli ci si riconosce sempre!
30 gennaio: Celebrata la missione millenaria della Abbazia di Novalesa
/0 Commenti/in news centenario, news-generali/da Fabio ZanchettaProprio beati
/0 Commenti/in Oggi è la parola/da EldradusIV Domenica T.O. –
La liturgia di oggi ci fa il grande dono di proclamare nella Chiesa – ancora una volta – l’evangelo delle Beatitudini. Per otto volte il Signore Gesù dice: <Beati…>. Si tratta di un testo che conosciamo a memoria, un testo che amiamo e, indubbiamente, un testo che ci provoca continuamente e sempre. L’intreccio delle letture offerte dalla liturgia della Parola ci permette di entrare nel castello delle Beatitudini attraverso un portale del tutto particolare che suona così: <Considerate la vostra vocazione, fratelli> (1Cor 1, 26). Questa esortazione di Paolo apre ad una comprensione delle Beatitudini nel senso che esse sono la nostra vocazione particolare di discepoli del Signore Gesù formati alla scuola dell’evangelo e conformati al mistero pasquale. Potremmo dunque chiederci quale sia la prima regola della felicità-beatitudine. La liturgia sembra dirci che la prima e fondamentale regola della felicità sia proprio la capacità di guardarsi allo specchio limpidamente e senza paura alcuna e accogliere il mistero della scelta di Dio: <ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti… ciò che nel mondo è debole per confondere i forti… ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato> (1Cor 1, 27-28). Alla fine di questa immersione nella scelta di Dio giustamente si può rimanere alquanto stupiti e inquietati: bisogna proprio prendere le cose alla rovescia. Ma la motivazione dell’apostolo non solo è in grado di chiarire ma pure di illuminare e convincere del fatto che non c’è altra scelta possibile. Egli dice: <perché nessun uomo possa gloriarsi davanti a Dio> (1, 29). Con queste parole dell’apostolo che cadono “casualmente” tra la prima e terza lettura di questa liturgia della Parola, siamo condotti al cuore delle Beatitudini siamo condotti al cuore della vita stessa di Dio che – secondo san Tommaso d’Aquino – è pura Beatitudine e somma Felicità. Solo se entriamo nella sua vita seguendo le regole del “gioco” della vita divina potremo sperimentare a nostra volta la pienezza della gioia. Ma tutto questo non è in noi e non dipende da noi bensì è pura partecipazione e dono gratuito. Così il primo versetto della liturgia di questa domenica risuona contemporaneamente come un appello e un programma: <Cercate il Signore voi tutti, poveri della terra> (Sof 2, 3).
A questa parola del profeta fa eco l’inizio assoluto del Discorso della Montagna che è racchiuso tra due beatitudini capaci di delineare l’orizzonte della felicità lasciando aperte tutte le variazioni e creazioni possibili di felicità e di gioia: dapprima <i poveri in spirito> (Mt 5, 3) e – in ultimo – <i perseguitati> (5, 10-11). Queste due beatitudini rappresentato la sintesi più forte della logica divina che il Signore Gesù proclama sul monte come la nuova pista attraverso cui possiamo serenamente attraversare i deserti della vita per giungere – compiuto l’esodo da noi stessi e ucciso il nostro egoismo – alla terra interiore della libertà vera: kenosi (svuotamento) e martyrìa (testimonianza fino allo stremo) sono la via offerta al discepolo per essere in tutto come il maestro e talora persino <di più> (Gv 14, 12). Spesso sentendo nel nostro cuore il termine <vocazione> (1Cor 1, 26) pensiamo a chissà quali appelli fino ad essere persino intimoriti che ci possa toccare in prima persona qualcosa di simile. Invece la nostra vocazione è riassunta dalla conclusione delle beatitudini: <Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli> (Mt 5, 3.10.12). Ma cosa sono mai questi cieli perché possano realmente interessarci fino ad essere oggetto di desiderio ardente e arrischiato?
I cieli che attendiamo non sono altro che la maturità del cielo che viviamo con la nostra capacità di riflettere sempre più e sempre meglio l’ordine, la beatitudine, la luce di Dio fino a poter <riposare senza che alcuno li molesti> (Sof 3, 13). Il cielo è questo riposo e la beatitudine non è altro che la capacità di attraversare la storia e le storie come un <popolo umile e povero> (3, 12).
Vraiment bienheureux
/0 Commenti/in Oggi è la parola/da EldradusIV Dimanche T.O. –
La liturgie d’aujourd’hui nous fait le grand don de proclamer encore une fois – en église – l’évangile des Béatitudes. Huit fois, le Seigneur Jésus dit : « Bienheureux … ». Il s’agit d’un texte que nous connaissons par coeur, un texte que nous aimons et, indubitablement, un texte qui nous provoque continuellement et toujours. La trame des lectures offerte par la Liturgie de la Parole nous permet d’entrer dans le château des Béatitudes par un portail particulier : « Aussi bien, frères, considérez votre vocation » ( 1 Co1, 26). Cette exhortation de Paul ouvre à une compréhension des Béatitudes, dans le sens qu’elles sont la vocation particulière des disciples du Seigneur Jésus, formés à l’école de l’évangile et en conformité avec le mystère pascal. Nous pouvons donc nous demander quelle est la première règle du bonheur-béatitude. La liturgie semble nous dire que la première règle fondamentale est la capacité de se regarder dans le miroir limpidement et sans aucune peur et accueillir le mystère du choix de Dieu : « ce qu’il y a de fou dans le monde pour confondre les sages…ce qu’il y a de faible dans le monde pour confondre la force …ce qui dans le monde est ignoble et méprisant » (1 Co 1, 27-28). A la fin de cette immersion dans le choix de Dieu l’on peut pourtant, justement, être étonnés et inquiets : il faut vraiment prendre les choses à l’envers. Mais la motivation de l’apôtre n’est pas seulement capable d’éclairer, mais aussi d’illuminer et de convaincre le fait qu’il n’y a pas d’autre choix possible. Il dit : « afin qu’aucune chair n’aille se glorifier devant Dieu » (1, 29). Par ces paroles de l’apôtre qui tombent, « par hasard » entre la première et la troisième lecture de cette liturgie de la Parole, nous sommes conduits au coeur des Béatitudes et au coeur de la vie même de Dieu qui – selon saint Thomas d’Aquin – est pure Béatitude et sommet du Bonheur. C’est seulement si nous entrons dans sa vie selon les règles du « jeu » de la vie divine que nous pourrons expérimenter à notre tour la plénitude de la joie. Mais tout cela n’est pas en nous et ne dépend pas de nous, c’est une pure participation et un don gratuit. Ainsi le premier verset de la liturgie de ce dimanche résonne de façon contemporaine comme un appel et un programme : « Cherchez le Seigneur, vous tous, pauvres de la terre » ( So 2, 3).
A ces paroles du prophète fait écho le début du Discours sur la Montagne contenu entre deux béatitudes capables de délier l’horizon du bonheur en offrant toutes les variations et les créations possible du bonheur et de la joie : tout d’abord « les pauvres en esprit » (Mt 5, 3) et – à la fin « les persécutés » (5,10-11). Ces deux béatitudes représentent la synthèse la plus forte de la logique divine que le Seigneur Jésus proclame sur la montagne ainsi que la nouvelle piste pour passer sereinement les déserts de la vie pour rejoindre – après avoir accompli l’exode et tué notre égoïsme – la terre intérieure de la vraie liberté : kenosi ( dépouillement ) et martyria ( témoignage jusqu’à l’extrême) : elles sont la vie offerte au disciple pour être en tout semblable au maître et peut-être même « d’avantage » ( Jn 14, 12). Souvent, en entendant dans notre coeur le terme « vocation » ( 1co 1, 26) , nous pensons à je ne sais quels appels jusqu’à être même intimidés qu’une telle chose puisse s’adresser personnellement à nous. Au contraire, notre vocation est résumée par la conclusion des béatitudes : « Réjouissez-vous et exultez de joie car votre récompense est grande dans les cieux » ( Mt 5, 3.10.12). Mais quels sont donc ces cieux qui peuvent réellement nous intéresser jusqu’à devenir objet de désir ardent et audacieux ?
Les cieux que nous attendons ne sont rien d’autre que la maturité du ciel que nous vivons par notre capacité de refléter toujours d’avantage et toujours mieux l’ordre, la béatitude, la lumière de Dieu jusqu’à pouvoir « se reposer sans que personne nous agresse » ( So 3, 13). Le ciel est ce repos et la béatitude n’est rien d’autre que la capacité de traverser notre Histoire et les histoires comme un « peuple humble et pauvre » (3, 12).
Abbazia SS. Pietro e Paolo
Borgata S. Pietro n. 4
10050 NOVALESA (TO)
Tel 0122 653210
Eucarestia
Abitualmente nei giorni feriali: 7:45
Domenica e solennità: 10:00
Orari Negozio
Martedì-venerdì 9:30-12:00 15:00-17:00;
Sabato 9:30-12:30 15:00-17:30 e domenica 11:00-12:30 15:00-17:30;
lunedì chiuso
Contatti
Frazione S. Pietro, 4, a Novalesa, a due passi da Susa in provincia di Torino.
Tel: 0122653210, mail info@abbazianovalesa.org